Recevez nos newsletters
Formation, Management, Commercial, Efficacité pro
Abonnez-vousYou are using an outdated browser. Please update your browser for a better experience
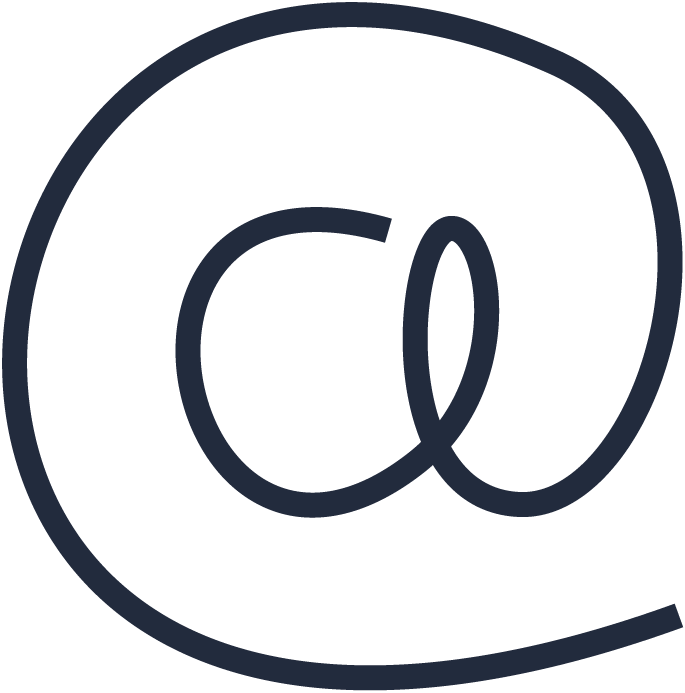

La confiance en soi est une capacité indispensable, tant dans la vie perso que pro. Pourtant près de 7 Français sur 10 estiment manquer de confiance en eux. Mais bonne nouvelle, rien n’est figé. Tout le monde est capable de booster sa confiance en soi, à condition d’apprendre à se connaître et d’y travailler régulièrement.
Avant de développer sa confiance en soi, mieux vaut savoir de quoi on parle exactement. « La confiance en soi, c’est cette capacité à se fier et à s’appuyer sur soi, traduit Eudeline Chabert d’Hières, coach et formatrice intervenante chez Cegos. C’est-à-dire, fondamentalement, je sais que je vais pouvoir me débrouiller et faire face à ce qui m’arrive. Que ce soient des problèmes ou des envies, tout ce qui se présente ou que j’ai envie d’accomplir. »
La confiance en soi est avant tout un regard sur soi, et ainsi être capable de prendre en compte ses qualités et ses défauts. À ne pas confondre avec l’estime de soi. « L’estime de soi, c’est la façon dont je me perçois par rapport à une certaine image que j’ai envie d’avoir de moi, précise notre experte. Elle est fluctuante, mais bonne quand je suis là où j’ai envie d’être. » La confiance en soi, en revanche, relève davantage d’une manière de se ressentir. « C’est se sentir capable d’affronter une situation, que ce soit résoudre un problème, décrocher un job, ou faire un feedback d’amélioration. »
68 % des Français.es estiment manquer de confiance en eux nous révèle une étude commandée en 2023 par l’enseigne Krys et relayée par Les Échos. Sans surprise, c’est donc aussi un sujet récurrent abordé lors de coachings avec notre spécialiste Eudeline Chabert d’Hières.
On imagine aisément l’impact d’un manque de confiance en soi dans un cadre professionnel : ne pas décrocher un poste, rater une promotion… « Je verrai même les choses davantage en amont, analyse notre formatrice. Quand vous avez confiance en vous, vous avez une joie qui génère un état d’esprit général positif. Au travail et dans la vie en général, c’est ce qui va vous permettre d’affronter tous vos défis. » Elle évoque des circonstances variées et concrètes : aborder un entretien d’embauche, décrocher une promotion, mais aussi faire face à un manager difficile ou encore recadrer un collaborateur ou une collaboratrice.
Car la confiance en soi impacte aussi sa relation aux autres, voire une ambiance générale de travail. « C’est une façon de gérer la pression au travail, et, dans un cycle positif, de garder des relations fluides avec ses collègues. Si j’ai confiance en moi, je vais avoir confiance dans les autres. »
Sur cette question bonne nouvelle : la confiance en soi est évolutive, donc à tout moment perfectible. « La confiance en soi a une histoire, poursuit notre spécialiste. Elle se constitue d’abord dans un certain environnement au départ, par rapport à un contexte familial, scolaire, puis professionnel. Il y a parfois un de ces milieux qui aura été plus favorable à la confiance en soi, ce qui fait que l’on se ressent comme une personne de valeur et de capable. » Mais tout le monde n’aura pas le même socle sur lequel s’appuyer. « Il arrive que l’environnement ait été moins favorable. Heureusement, il est possible de corriger cela. »
Eudeline Chabert d’Hières l’assure : il n’y a pas de déterminisme de la confiance en soi. « C’est choisir la personne que j’ai envie d’être et travailler dans ce sens. On est acteur, ou actrice, de sa confiance en soi. Je peux d’autant mieux consolider ma confiance en moi si j’accepte la responsabilité de mon manque de confiance. Sortir de l’attitude victimaire est important. D’ailleurs, si on est persuadé de l’inverse autant s’arrêter là ! » Mais on aurait tort…
« La confiance en soi se travaille », poursuit l’experte en convoquant la métaphore du jardin. « On m’a donné un terreau où des graines ont été plus ou moins semées. De mon côté, en quoi ai-je contribué à ce terreau de départ ? Aux premières semences ? Aux premières pousses ? Ensuite, je peux continuer de jardiner, enlever les plantes que je n’aime pas, rajouter celles que j’aime. Je peux encore apporter du terreau, faire attention à mes racines, etc. » Mais on n’est jamais seul. Écouter les remarques et les feedbacks des autres aide aussi à construire cette confiance. « Mais si j’ai soif de compliments, c’est peut-être que je ne me nourris pas assez. Chacun se construit dans une interaction équilibrée. », ajoute notre experte.
Pour tester sa confiance en soi encore faut-il savoir d’où l’on part. Même si, en général, on en a une petite idée. « Quand j’accompagne des personnes, je leur soumets au sol une échelle de la confiance et de l’estime et je demande à chacun de s’évaluer de 0 à 9. Il s’agit de prendre contact avec ses émotions et son corps. D’emblée, cela donne déjà une idée d’où on se place et où on a envie d’aller. » Pour l’évaluer, on peut aussi interroger les autres. « Tous les feedbacks et perceptions des autres sont également précieux à cet égard. »
Pour aller plus loin, la coach utilise les travaux du psychologue statisticien américain Will Schutz. Certifiée Élément Humain®, elle utilise l’un de ses questionnaires pendant ses formations. « Cet instrument de mesure permet de savoir où on en est par rapport à sa confiance en soi et où on a envie d’aller. Et surtout avoir confiance en soi… en sachant pour faire quoi, concrètement. »
Améliorer sa confiance en soi est un travail de tous les jours. Pour la booster avant un rendez-vous professionnel important, Eudeline Chabert d’Hières suggère trois approches.
- Écouter sa respiration. « Quand j’ai confiance en moi, je me sens vivant. Et tout cela part de la respiration. Les neurosciences l’ont démontré : la respiration permet de réguler les bonnes hormones du stress. Elle permet de prendre contact avec soi, de ressentir ses émotions et de les accepter. »
- S’immerger dans des succès récents, aussi petits soient-ils, et pas forcément dans le domaine professionnel. « On peut songer à des feedbacks sympathiques d’amis. Dans la quinzaine précédente, on identifiera forcément des choses que l’on a bien faites. L’idée est de se reconnecter à l’émotion ressentie à ce moment-là. »
- Visualiser ses points faibles… et les accepter, voire les partager. « Si je suis émue avant une prise de parole, explique notre formatrice, je peux le dire et l’évacuer en début de présentation. Parce que, de toute façon, les autres le verront. Une fois ce sujet évacué, l’important sera ailleurs, dans ce que je veux dire. Comme le dit justement le psychologue Will Schutz, la vérité est le plus grand simplificateur dans les relations. Et la première vérité est d’être en vérité avec soi. » Avoir confiance en soi n’est pas toujours se sentir en pleine puissance : cela peut être juste accepter ses plus et ses moins.
Lire aussi : Travailler sa confiance en soi : comprendre, identifier et agir
Cegos propose une formation sur la confiance en soi sur deux jours. « C’est un premier pas important, c’est le début d’un process plus général, rappelle notre formatrice. L’intérêt d’une formation est deprendre conscience de son mode de fonctionnement. Nous tendons un miroir avec plein de facettes et chacun décide ce qu’il en fait. Chacun reste acteur de sa confiance en soi. »
Une formation pose les bases et propose un plan d’action personnel. À charge pour la participante ou le participant de le mettre en œuvre pour se comporter différemment.
Lire aussi : La confiance ou la peur
Notre spécialiste compare volontiers la confiance en soi à une grosse valise. Une fois que celles-ci est remplie, on en fait quoi ? « C’est pourquoi il est important de donner un contexte à la confiance. J’ai envie de m’appuyer sur moi, mais pour faire quoi ? Est-ce que je veux développer mon réseau ? Décrocher une promotion ? Mieux manager ? Il peut même s’agir de faire face à des changements de vie majeurs comme un départ à la retraite. »
Une fois lancé, on sera vite récompensé de ses efforts. Parmi les avantages à attendre, Eudeline Chabert d’Hières rappelle par exemple qu’une meilleure confiance en soi permet de mieux appréhender l’échec. « Un manque de confiance en soi peut créer les conditions d’un échec qui, ensuite, ébranlera encore davantage la personne concernée. À l’inverse, si la confiance en soi est bonne, elle se nourrira de cet échec pour progresser, apprendre. On sera capable de prendre de la hauteur. Au lieu de voir ce qui n’a pas marché, on observe ce qui a fonctionné pour faire mieux la prochaine fois. »
Cette démarche peut aussi générer une meilleure cohésion d’équipe. « Au travail, ce questionnement peut provoquer un bel effet domino. En se libérant de certains freins, on va dégager plus d’énergie. Sans compter qu’un·e manager qui ose afficher sa vulnérabilité peut aussi susciter des solidarités nouvelles, et faire le plein de complémentarités. »
Ce nouvel élan sera progressif, mais durable. « Une meilleure confiance en soi ne peut se développer que si on se lance dans des actions régulières, aussi petites soient-elles, rappelle notre coach. C’est comme une gymnastique nouvelle, régulière et indispensable… »
Pour aller plus loin sur cette thématique :
Opération impossible